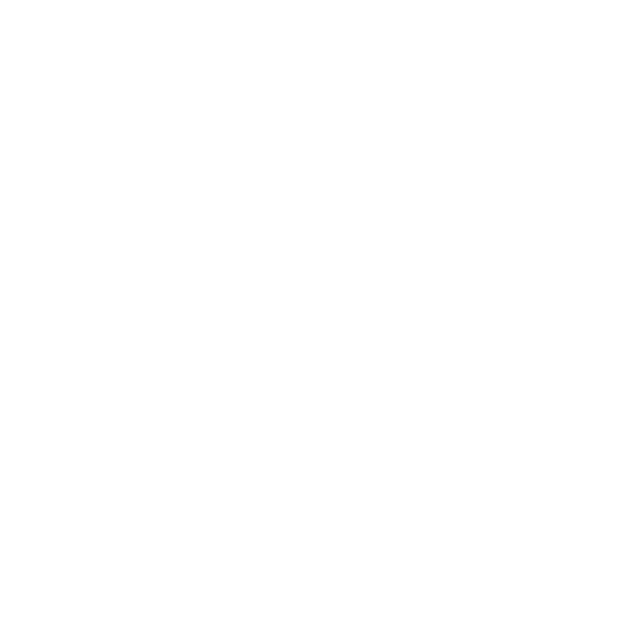- lundi 19 avril 2021 – Jacques Paquier

L’Association des maires d’Ile-de-France (Amif) a innové, vendredi 16 avril 2021, en organisant un colloque sur la résilience des territoires sur une plateforme immersive en 3D. Les défis posés par les révolutions climatiques, sanitaires et digitales en termes d’approvisionnement, d’équipements publics et de santé figuraient à l’ordre du jour.
« Construire la résilience de nos territoires à l’épreuve des crises sanitaires et environnementales ». Le colloque immersif en 3D, organisé par l’Association des maires d’Ile-de-France (Amif) avec la plateforme « Virbela » n’a pas sacrifié le fond pour la forme. Au contraire, les possibilités offertes par le truchement d’un avatar facilitent la concentration et le suivi des échanges, permettant en outre les contacts interpersonnels entre les participants. En introduction des débats, Stéphane Beaudet, président de l’Amif, et Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, tout comme Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris, en conclusion, ont souligné l’investissement des élus locaux, en première ligne depuis le début de la pandémie.
Lors d’une première table ronde consacrée à l’énergie, l’alimentation et l’eau intitulée « Comment se prémunir et gérer les crises d’approvisionnement ? », Frédéric Courleux, spécialiste de la politique agricole commune (PAC), assistant parlementaire du député européen Eric Andrieu (PS), a critiqué les règles internationales proscrivant la constitution de stock alimentaire, au nom de la théorie libérale selon laquelle il ne faut pas fausser les équilibres des marchés. « On a aujourd’hui en France des stocks stratégiques de pétrole (90 jours) mais pas de stocks alimentaires, a-t-il constaté. Les règles de l’OMC interdisent les politiques de stockage. Mais beaucoup de pays ne respectent plus ces règles, comme la Chine qui a neuf mois de réserves en céréale. En Europe, on est à moins d’un mois. L’UE est un facteur de déstabilisation du marché alimentaire mondial. On a donc un long chemin à parcourir pour arriver à plus de résilience alimentaire et à une forme d’autonomie. Le grenier est le cœur du village : on a besoin de reprendre la main sur l’alimentation, le stockage est fondamental », a-t-il fait valoir.
Une PAC « aveugle »
Frédéric Courleux a également critiqué une PAC attribuant, au titre de son premier pilier, ses subsides aveuglément, sans distinction de type de culture et de méthodes agricoles. Le collaborateur d’Eric Andrieu espère que la définition du plan stratégique national (PSN) permettra de parvenir à déployer plus de moyens pour l’agriculture biologique afin d’atteindre l’objectif européen de 25 % de surfaces bio en 2030. Il convient également, selon lui, de mieux répartir l’élevage sur le territoire pour éviter les effets de concentration. « L’élevage est un fort émetteur de gaz à effet de serre (GES) mais permet aussi d’apporter des solutions comme le stockage du carbone dans les sols », a-t-il souligné.
Bertrand Manterola, directeur régional et interdépartemental adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France (DRIAAF), a décrit les projets alimentaires territoriaux (PAT), présentés comme des leviers efficaces pour faire travailler ensemble des agriculteurs, des grossistes et les consommateurs au service d’objectifs communs. « On a une dizaine de PAT aujourd’hui en Ile-de-France, a-t-il indiqué. C’est la manière la plus adaptée de faire travailler ensemble ces acteurs, en tenant compte de la réalité de chaque territoire. Si l’on considère que la priorité est l’approvisionnement des cantines scolaires, on peut par exemple financer la mise en place d’un atelier de conditionnement et d’épluchage des légumes locaux, ou la formation des cuisiniers… ».
« Presque 13 millions de Franciliens peuplent le territoire : le rapport entre production agricole et besoins alimentaires est fortement déséquilibré », a-t-il encore souligné. Ainsi, aujourd’hui, on ne produit en Ile-de-France que 3 % de ce que l’on consomme. La céréaliculture a été soumise à de fortes contraintes liées au réchauffement climatique, a également noté le représentant du ministère de l’Agriculture. La filière betterave, confrontée à la jaunisse l’an dernier et au gel cette année, est en péril.
Bertrand Manterola a insisté sur l’enjeu du remplacement des départs à la retraite d’agriculteurs. « Il faut structurer la demande croissante de produits locaux, via la PAC et le plan France relance, pour faciliter l’accès aux productions locales pour les ménages modestes qui ont moins cette habitude », a-t-il également souligné.
Souveraineté logistique
Inès Balligand (Sogaris) a pour sa part décrit la révolution du e-commerce, qui a inversé les proportions de la logistique, passées de 2/3 BtoB à 2/3 BtoC. « La souveraineté logistique implique la maîtrise du foncier par les pouvoirs publics, a-t-elle fait valoir, avec la nécessité de la mise en place d’un maillage logistique plus resserré. Il faut trouver dans les PLU/PLUI des outils pour hybrider les usages des espaces, et plus seulement des plateformes logistiques qui ne répondent plus bien aux besoins des territoires ».
Enfin, Sylvain Chapon, operational marketing executive d’Engie, a rappelé que la mission d’un énergéticien consistait à assurer un approvisionnement à tout moment, pour éviter les ruptures. Ce qui induit une diversification des sources d’approvisionnement avec, désormais, « un choix de plus en plus large d’énergies renouvelables ». « Nous allons vers des sources d’énergie toujours plus vertes, efficaces sur le plan énergétique, avec un impact carbone plus faible », a-t-il souligné.
Lors de la table ronde sur la résilience des équipements publics, Ludovic Faytre, du département environnement urbain et rural de l’Institut Paris Region a rappelé notamment qu’une grande inondation de la Seine restait la principale catastrophe qui pourrait survenir sur le territoire francilien. « Nous y sommes très mal préparés », a-t-il souligné. Le coût d’une inondation majeure serait de plusieurs dizaines de milliards en dépenses directes et de plusieurs dizaines de milliards en coûts indirects. « La territorialisation de la gestion du risque, notamment de construction, est la solution à privilégier », considère l’expert, qui a appelé de ses vœux une solidarité plus grande entre les territoires, entre amont et aval dans le cas des inondations.
Sylvie Angeloni, de la direction des constructions publiques et de l’architecture de la ville de Paris, a évoqué la difficulté à gérer plusieurs crises simultanées. « Les documents de gestion des crises doivent être en interaction », a-t-elle plaidé.
« CartoZIP » et porter-à-connaissance
Alexandre Léonardi, chef de service prévention des risques et des nuisances à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France (DRIEAT), a rappelé l’existence du porter-à-connaissance (PAC), fourni par le préfet et transmis aux communes dès lors que des données liées au risque sont connues, en particulier celles concernant les mouvements de terrains ou les inondations. Il a rappelé l’utilité des guides d’autodiagnostic, disponibles sur le site Internet de la DRIEAT, pour que chacun puisse estimer sa vulnérabilité. CartoZIP, outil de culture du risque développé avec l’Institut Paris Région à destination des citoyens, permet de visualiser les emprises inondées en fonction des niveaux de crues, a-t-il également indiqué.
« Face au Covid, nous avons su nous adapter aux besoins dans des délais efficaces, a indiqué Xavier Léty, président de RATP cap Ile-de-France. Aux besoins de trafic, mais aussi à ceux d’acheminement vers les centres de vaccination par exemple. En trois jours, un million d’autocollants ont été posés pour la distanciation et le nettoyage renforcé, nécessitant un doublement du budget », a-t-il fait valoir. « La résilience impose une grande humilité. Depuis un an, personne n’avait de modèle pour simuler les trafics », a-t-il également souligné.
Enfin, Adina Revol, conseillère économique à la représentation de la Commission européenne en France, est revenue sur le plan de relance européen, d’une ampleur inédite, fléchée vers une Europe « plus résiliente, plus écolo, plus sociale, plus numérique. Cela avec une dette commune, ce qui est sans précédent ».
Lors de la table ronde consacrée aux enjeux de résilience des territoires en matière de santé, Jonathan Ardouin, directeur général de Livi, a décrit l’apport de la téléconsultation, « qui permet d’élargir les horaires de consultation par rapport aux horaires classiques des cabinets, de désengorger les urgences, de pallier le manque de médecins traitants ». Mais pour Ludovic Toro, maire de Coubron et président de la commission santé de la métropole du Grand Paris, l’avènement de la téléconsultation signe l’échec de notre système de santé. « Il vient apporter des solutions à des problèmes qu’on aurait pu éviter. Rien ne remplace le présentiel », a-t-il souligné.
Bernard Jomier, corapporteur de la commission d’enquête sénatoriale sur le Covid, a estimé que la répartition de l’exercice de la compétence santé est la question centrale du moment. Il a souligné la nécessité d’une décentralisation « qu’il faut accompagner d’une articulation des acteurs entre eux ». « Il faut articuler les maires avec les services centraux de l’Etat, les acteurs de santé locaux avec les élus. Les agences régionales de santé doivent être mieux insérées dans les territoires et plus en lien avec les élus locaux », a-t-il estimé.
« C’est la Région qui devrait avoir une compétence en la matière, juge le parlementaire, ce qui n’empêche pas que les autres niveaux puissent avoir des compétences, mais la discussion avec l’Etat ne va pas être simple car L’Etat n’a pas envie de partager ses compétences ».
Mais pour Gilbert Hangard, président de l’association Elus, santé publique et territoires, le paradigme selon lequel la santé serait l’affaire exclusive de l’Etat est en train d’évoluer face au principe de réalité. « Il faut une articulation entre les élus puisque c’est un sujet éminemment transversal », a-t-il déclaré à son tour. Gilles Hangard a listé six urgences locales : pénurie médicale, crise de la démocratie sanitaire, paupérisation, explosion des maladies chroniques, crise du vivre ensemble.
Enfin, Luc Ginot, directeur de la santé publique à l’agence régionale de santé Ile-de-France, a justement rappelé que l’ARS souhaite travailler avec les élus. « Les mécanismes qui font les inégalités de santé ont été criants avec la crise sanitaire », a-t-il indiqué, rappelant les interactions entre la santé et le champ socio-économique. « La pandémie a également fait apparaitre des innovations », a-t-il relevé, citant la téléconsultation, les barnums de dépistage et l’open data.